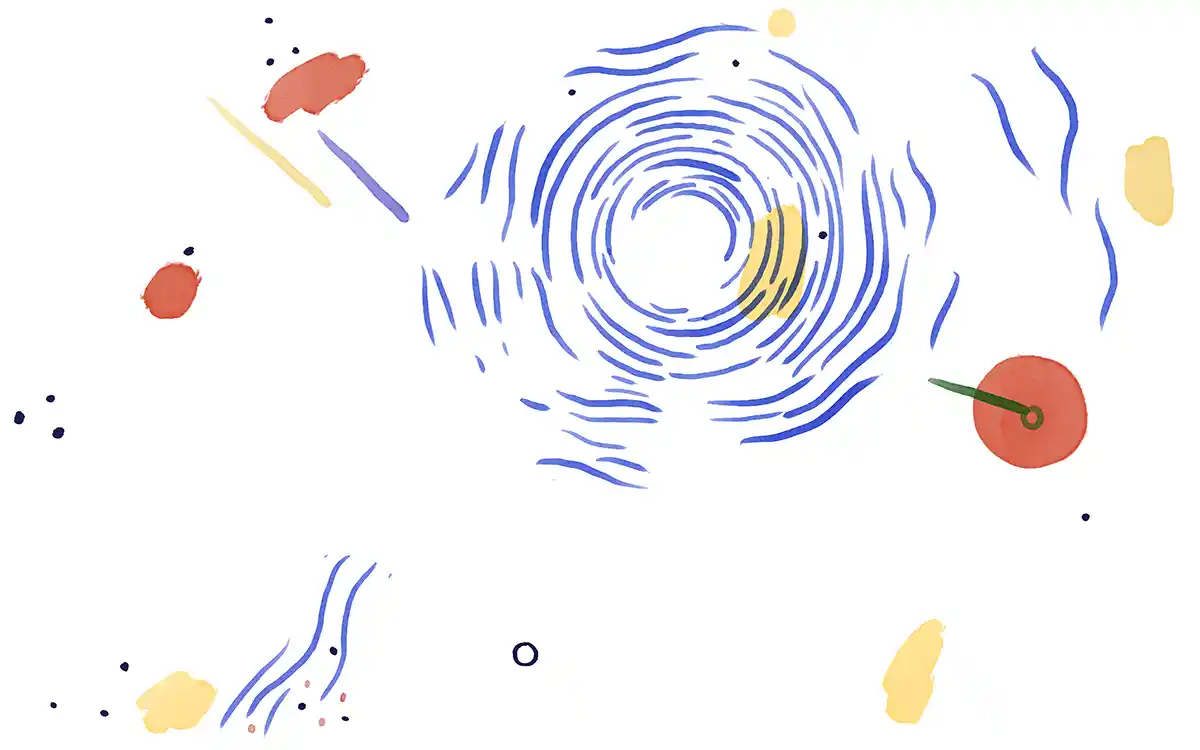De l’auditeur curieux à l’auteur sonore affirmé, le podcast a vu émerger une diversité de pratiques, de gestes et de postures. Toutes ne se ressemblent pas, mais elles partagent un même espace d’écoute, vivant et mouvant. Un continuum où chacun·e invente sa manière de tenir le micro.
L’autoproduction : liberté exigeante, autonomie fragile
Beaucoup entrent dans le podcast comme on cherche un ton juste : par curiosité, par nécessité, par envie de dire quelque chose que d’autres n’ont pas encore dit.
Cette liberté a longtemps été une promesse du médium. Contrairement à la radio, régie par des grilles, des formats et des équipes, le podcast a permis à chacun·e d’ouvrir un espace sonore personnel, à sa mesure. Mais cette liberté a un prix. Là où la radio associative peut s’appuyer sur un tissu de bénévoles et quelques soutiens institutionnels, le podcast reste largement autoproduit. Il n’existe aucun équivalent des aides publiques au cinéma, à la presse ou au jeu vidéo.
Produire, c’est investir son temps, souvent son argent, et apprendre sur le tas. Ce geste libre est souvent solitaire, artisanal, exigeant : une autonomie fragile mais féconde.
Les auteurs sonores : trajectoires plurielles et collectives
Chez certains, ce geste d’autoproduction devient une trajectoire à part entière.
Julien Cernobori incarne cette démarche d’auteur-autoproducteur : après de longues années à Radio France puis un passage par le studio Binge Audio, il écrit, réalise, enquête et diffuse aujourd’hui en toute indépendance. Son podcast “Cerno l’anti-enquête”, mené au long cours, mêle documentaire et récit personnel. Il illustre une forme d’autonomie exigeante, parfois contrainte, mais profondément libre.
À ses côtés, Théo Boulenger, compositeur, auteur, réalisateur et parfois producteur, navigue entre créations personnelles, commandes et coproductions. Il collabore notamment à la musique du podcast de Julien, tout en développant ses propres projets. Il lui arrive aussi d’être coproducteur sous forme d’apport en industrie, au sein de réseaux d’entraide qui compensent l’absence de financements institutionnels.
Leur collaboration dit beaucoup du podcast d’aujourd’hui : des écritures à plusieurs mains, nourries par la solidarité technique et artistique.
Autour d’eux, d’autres travaillent dans le même esprit. Des collectifs comme Transmission incarnent cette idée d’une économie de l’entraide, où chacun·e prête sa voix, son savoir-faire, son matériel. Le son s’y fabrique ensemble, dans des dynamiques souples, inventives et ouvertes.
Ces auteurs sonores contemporains réinventent un modèle d’écriture à la fois singulier et partagé. Le geste n’est plus isolé : il s’inscrit dans des réseaux de coopération, d’écoute mutuelle, de compagnonnage sonore. Une dynamique qui, on l’espère, continuera de se renforcer.
Le continuum : un espace partagé, inégalement visible
Ce qui relie toutes ces démarches, c’est aussi le même espace de diffusion. Par nature, le podcast place côte à côte des contenus issus de la radio publique, de collectifs indépendants, d’auteurs solitaires ou de studios privés.Tous coexistent sur un même terrain d’écoute.
Mais cette égalité est trompeuse. Les plateformes, les algorithmes et la force des marques influent sur la visibilité. Un créateur isolé n’aura pas la même portée qu’un média reconnu ou qu’une figure déjà visible ailleurs.
Le podcast reste donc un espace commun, mais traversé d’asymétries. Et pourtant, c’est ce partage, parfois fragile, souvent invisible, qui le rend vivant. Entre les structures établies et les voix indépendantes, se dessine un continuum de pratiques et de présences : autant de façons de tenir le micro, d’habiter le son et d’en renouveler les usages.
C’est sans doute là que réside l’enjeu : relier ceux qui tiennent le micro et ceux qui écoutent, au-delà des bulles et des affinités.
Car si le podcast reste un territoire commun, il reste à l’habiter pleinement.
Chez Elson, nous cherchons à créer ces passerelles : relier créateurs, auditeurs, curieux.
Dans nos formations comme dans nos accompagnements à la production, nous transmettons cette même idée : apprendre à faire, à écouter, à partager le son avec exigence et curiosité.
Les formes de légitimité : apprendre en faisant
Dans cet écosystème mouvant, la question de la légitimité se pose autrement.
Ici, on ne la décrète pas : on la construit, pas à pas, en expérimentant, en publiant, en affinant peu à peu sa signature sonore. Pour beaucoup de créateurs et créatrices, c’est un apprentissage par la pratique. Un processus lent, fait d’essais, de doutes et d’endurance.
Parmi eux, plusieurs anciens apprenants et apprenantes d’Elson poursuivent aujourd’hui leur chemin sonore. Leur parcours illustre ce que peut devenir une démarche commencée en formation : un projet au long cours, mené en parallèle ou en prolongement d’une activité principale, mais nourri par la même exigence de sens et de rigueur.
Jérémy Thomas, avec Sens de la visite, a transformé un projet personnel sur l’art en un véritable travail d’auteur, mêlant narration, expérimentation et médiation. Stéphanie Gruet-Masson, avec son podcast sur l’autisme, a construit une autorité douce et précieuse, fondée sur la justesse et la connaissance intime du sujet. Et Claire Flury, enfin, incarne la persévérance : à plus de soixante-dix ans, elle vient de publier le centième épisode et dernier épisode de PLAFF, sa série consacrée aux femmes de plus de cinquante ans dans le monde du travail.
Ces parcours n’ont rien d’exceptionnel : ils sont le reflet d’un apprentissage collectif et d’une curiosité durable. Chacun à sa manière, ces créateurs apprennent en faisant, affinent leur regard, structurent leur démarche. Leur professionnalisation ne passe pas toujours par des revenus, mais par la reconnaissance de leur savoir-faire et de leur place dans l’écosystème du podcast.
Entre indépendance et exposition : d’autres manières de tenir le micro
Le podcast est aussi devenu un espace de présence assumée.
Certaines voix s’y sont affirmées comme des repères, des incarnations du médium, sans pour autant s’y enfermer.
Anne Guesquière, avec Métamorphose, a construit un univers de parole ouvert, entre introspection, transmission et spiritualité.
Charlotte Bienaimé, avec Un podcast à soi produit et diffusé par Arte Radio, prolonge l’héritage radiophonique dans une écriture documentaire exigeante et profondément féministe.
Mais bien au-delà de ces figures reconnues, de nombreux créateurs et créatrices s’emparent du podcast pour prolonger leur pratique professionnelle : journalistes, artistes, thérapeutes, chercheurs, entrepreneurs, formateurs…
Ils y trouvent un espace de liberté, de transmission, parfois un outil de visibilité ou de communauté.
Certains développent des podcasts de niche, centrés sur un sujet, une expertise, une affinité ; d’autres construisent autour d’eux de véritables écosystèmes d’écoute.
Et parfois, la frontière s’efface : dans ces formats conversationnels qui se multiplient, on ne sait plus très bien qui, du micro ou de la parole, conduit l’échange.
Le podcast devient alors moins un espace d’écriture qu’un lieu de stratégie, où la parole circule, s’agrège, se renforce, au risque, parfois, de s’uniformiser.
Habiter le son
Et pourtant, derrière cette diversité de formats et de postures, une même envie persiste : celle de faire entendre sa voix, de partager un regard, d’habiter le son à sa manière.
Alors, qui tient le micro ?
Tous, à leur manière. Les créateurs passionnés, les auteurs sonores, les collectifs, les figures médiatiques. Chacun·e y trouve un mode d’expression, une façon de relier sa voix à celles des autres. Le podcast, depuis ses origines, tient dans cet équilibre : un média libre, partagé, mouvant. Un espace où l’on peut tout à la fois créer, écouter, transmettre.
Et peut-être que tenir le micro, aujourd’hui, ce n’est pas parler plus fort.
C’est apprendre à écouter autrement.