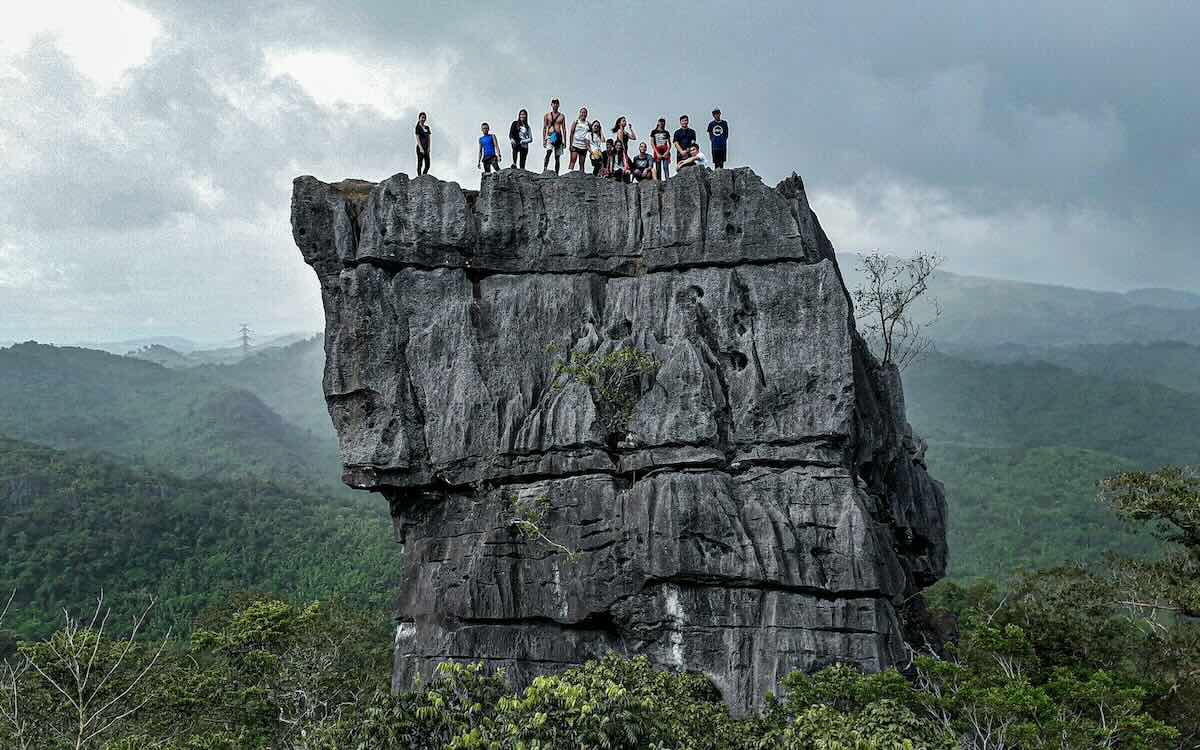Trois ans après sa création, l’aide sélective à l’écriture a soutenu de nombreuses auteurs et autrices. Mais le bilan qui vient d’être rendu public montre que l’essentiel reste à faire : aider les projets à passer de l’écriture à la production et à la diffusion.
Un bilan de l’aide sélective aux auteurs et autrices de podcasts
Le rapport dresse un état des lieux précieux. Il confirme que l’aide remplit bien sa mission initiale : soutenir l’amont du processus. Mais il met aussi en lumière une limite nette : seule une minorité des projets aidés atteint aujourd’hui le public avec 36 % des lauréat·es 2021 qui ont diffusé leur œuvre, 17 % pour 2022. Écrire est une chose ; produire et diffuser en est une autre.
Bonne nouvelle cependant : l’Inspection générale des affaires culturelles recommande de poursuivre le dispositif mais aussi de le faire évoluer :
– maintenir un soutien à l’écriture,
– créer une aide sélective à la production,
– réfléchir à un soutien structuré à la diffusion,
Le rapport préconise la création d’une aide sélective à la production, comme l’avait déjà suggéré le rapport de l’IGAC en 2020 (qui s’interrogeait alors sur le modèle du CNC : un écosystème structuré autour d’aides publiques venant compléter l’investissement des diffuseurs aux côtés des auteurs et des producteurs).
À l’époque, cette perspective semblait séduisante : entre 2018 et 2022, plusieurs plateformes (Spotify, Amazon, Audible, Sybel, etc.) ont financé des productions locales en confiant à des studios indépendants la réalisation de programmes originaux. Mais ces initiatives se sont depuis largement retirées, fragilisant les studios et laissant les auteurs et autrices sans perspective claire.
Un appui public direct à la production devient aujourd’hui indispensable pour permettre aux projets ambitieux d’aboutir et d’être diffusés.
De l’écriture à la production : un passage encore trop fragile
Chez Elson, nous le constatons depuis plusieurs années : beaucoup de créateur·ices atteignent un stade solide, une écriture construite, parfois des pilotes, un début de production mais restent bloqué·es faute d’accompagnement pour aller plus loin.
Or ce rôle, la formation peut déjà le jouer. C’est précisément par ce processus que des projets gagnent en maturité : ils n’y seraient pas arrivés autrement. À travers nos formations documentaires, nous avons accompagné des auteur·ices dont six projets sont arrivés à maturité, dont deux ont même obtenu l’aide sélective sans pouvoir aboutir faute de relais. La formation n’est donc pas un simple préambule, mais un maillon essentiel du processus de création.
L’émergence des auteur·ice·s-producteur·ice·s
Le rapport n’ouvre pas encore cette réflexion, mais elle devient incontournable : comment soutenir un écosystème d’auteurs qui portent eux-mêmes leur production, parce que les studios sont contraints et que les diffuseurs publics ne peuvent accueillir qu’une infime partie des œuvres ? Dans un paysage où l’autoproduction est souvent la seule voie possible, c’est précisément ce terrain qu’Elson explore depuis plusieurs années.
À travers nos formations documentaires, nous avons accompagné des auteur·ices qui sont devenus capables de porter leur projet dans toutes ses dimensions. Six projets sont aujourd’hui arrivés à maturité, dont deux ont même bénéficié de l’aide sélective sans pouvoir aboutir faute de relais. Ce constat nous montre que l’« auteur-producteur » existe déjà, mais qu’il reste fragile et insuffisamment reconnu.
Par ailleurs, notre travail de curation et d’écoute nous le confirme : de nombreux podcasts pourraient aller plus loin (gagner en professionnalisation, trouver un modèle économique, se diffuser plus largement) si un accompagnement structuré leur permettait de franchir ce cap. C’est toute la chaîne de valeur qui est concernée : de l’écriture à la production, jusqu’à l’édition et la diffusion.
À ce stade, nous aurions aimé voir apparaître une recommandation n°6 :
Engager des dispositifs qui favorisent l’accompagnement des auteurs et autrices entre l’écriture et la production, notamment par la formation, afin de leur donner les outils nécessaires pour assumer ces différentes casquettes.
Cette proposition prolongerait utilement les recommandations existantes et contribuerait à structurer l’écosystème.
De la production à la diffusion : un chantier à ouvrir
Le rapport souligne la nécessité d’un soutien à la production, mais il reste un autre enjeu clé : la visibilité des œuvres une fois qu’elles existent. Le rapport évoque le rôle qui pourrait revenir à Radio France. Mais l’écoute des podcasts se fait aujourd’hui largement aussi sur des plateformes tierces ; réfléchir à la découvrabilité supposerait d’intégrer ces usages réels et d’imaginer, peut-être, des formes de curation ou d’exigences de mise en avant adaptées à cet écosystème ouvert.
Ce glissement se lit même dans les mots : quand l’aide a été lancée en 2021, elle s’intitulait « aide sélective aux autrices et auteurs de podcasts et de créations radiophoniques ». Quatre ans plus tard, il s’agit du “bilan de l’aide aux autrices et auteurs d’audio à la demande ».
Ce changement de vocabulaire reflète la diversité des usages du sonore sur l’espace numérique, mais également l’élargissement et la dilution du terme « podcast » dans tout l’écosystème : il englobe désormais autant des formats vidéos, des conversations, des contenus de personal branding que des créations sonores exigeantes. Nommer ces œuvres reste essentiel si l’on veut vraiment penser leur accompagnement et leur diffusion.
Vers une chaîne de valeur établie et partagée
Le bilan du ministère n’est pas une mauvaise nouvelle : il prolonge un dispositif utile et propose de combler ses angles morts. Mais il rappelle surtout que soutenir l’écriture ne suffit pas.
Sans accompagnement, sans aide à la production et sans politique de diffusion, beaucoup de récits resteront à l’état de fichiers sur un disque dur. Et sans réflexion sur la formation et la valeur partagée, l’écosystème sonore restera fragile.
Car ces enjeux de valeur partagée se posent déjà, dès la production : comment répartir les rôles et les responsabilités entre un auteur, un réalisateur, un producteur, un diffuseur, et les plateformes qui rendent les œuvres visibles ? Ce sont des questions qui, à moyen et long terme, alimenteront forcément le projet Elson Podcast. Mais elles se posent dès aujourd’hui, dans la manière dont les auteurs portent leurs projets et dont les structures peuvent, ou non, les accompagner.