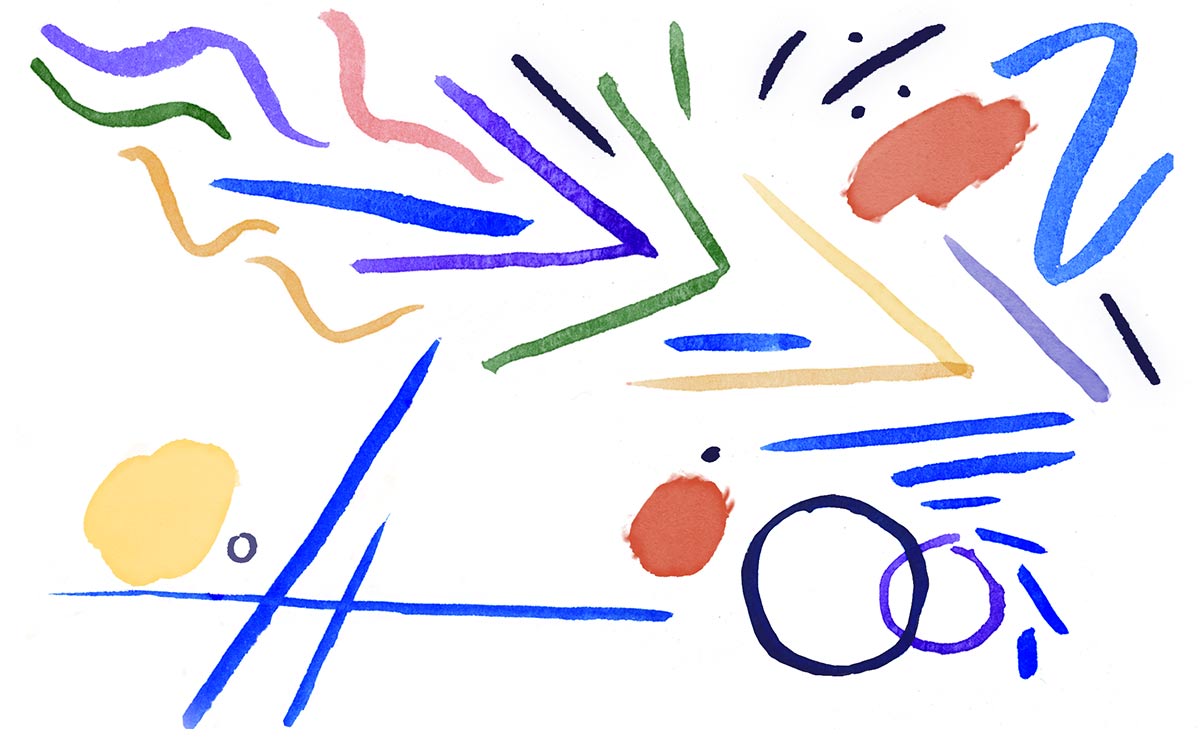Né dans l’héritage de la radio, le podcast a d’abord été un espace d’écoute intime, en marge des réflexes sociaux. Les plateformes imposent désormais leurs logiques d’attention, au détriment de la création sonore.
Le podcast comme espace d’écoute
À ses débuts, le podcast n’avait rien de « social » au sens numérique : pas de likes, pas de commentaires, pas de partages automatisés. C’était un espace de retrait, de concentration, où l’on prenait le temps d’écouter sans être interrompu. On s’y abonnait, on suivait un podcast, on prenait le temps de découvrir des épisodes et des nouveaux créateurs. Bref, un média qui se vivait à l’oreille, et qui se transmettait souvent d’une oreille à l’autre, par la recommandation humaine, le bouche-à-oreille, le partage entre pairs.
À mesure que le podcast entrait dans l’écosystème des plateformes, l’attention est devenue une ressource à capter, un capital à faire circuler. Le podcast, autrefois refuge sonore, tend à devenir un produit formaté pour l’économie de l’attention. Une économie qui privilégie la publication effrenée plutôt que la profondeur, la parole facile plutôt que le récit. Les écritures s’effacent et les formes sonores les plus exigeantes reculent.
Dans ce nouvel écosystème numérique, le sonore s’est vite heurté à une question : comment exister dans un monde pensé pour la visibilité ?
Les tentatives de rendre l’audio social
À partir de 2015, on a vu fleurir les audiogrammes : des vidéos avec une image en fond, une courbe d’onde animée pour représenter le son et le mouvement, et plus tard des transcriptions textuelles. Le son en simili-vidéo, pour pouvoir circuler d’abord sur Facebook et Twitter. Le son se traduisait alors en image, pour pouvoir exister dans le flux. Sur YouTube, en revanche, où l’on peut ouvrir un onglet et laisser tourner, diffuser un épisode entier pouvait parfois fonctionner… à condition d’avoir une notoriété suffisante pour émerger.
C’est à ce moment-là que la frontière entre podcast et vidéo s’est brouillée — une mutation que Spotify tentera plus tard d’imposer à l’échelle mondiale. Nous revenons sur ce glissement dans notre article “Du RSS à la vidéo : comment Spotify et YouTube essaient de déplacer le podcast”.
Résultat : d’un côté, des teasers courts, calibrés pour l’instantanéité des réseaux sociaux ; de l’autre, des contenus longs tolérés par un usage multitâche. Dans les deux cas, l’écoute se réduit à un format de compromis.
Les créateurs ont joué le jeu, parfois avec inventivité : teasers graphiques de 20 ou 30 secondes, extraits choisis pour accrocher l’attention, stories ou vidéos adaptées à Instagram. Ces objets ont souvent produit un effet ambivalent : le visuel séduit, mais le contenu peut décevoir les oreilles exigeantes. Et surtout, un visionnage social ne se transforme pas en écoute. Ce qui, au départ, relevait du bricolage créatif ou d’une stratégie ponctuelle pour exister dans le flux, s’est peu à peu transformé en modèle.
En reprenant ces codes, les plateformes audio et vidéo tentent d’en faire une norme. Elles veulent faire croire que le podcast doit adopter les réflexes du social : être filmé, découpé en extraits rapides, pensé pour le scroll.
Pour ceux qui souhaitent creuser davantage cet aspect historique de l’audio social, on vous renvoie à une conférence donnée par Carine Fillot, fondatrice d’Elson à ParisWeb en 2016 « L’audio n’a pas dit son dernier mot ». Carine posait déjà la question : « L’audio peut-il être un réseau social ? » et présentait notamment Anchor, start-up encore quasi inconnue en France, qui ambitionnait de devenir le « Twitter de l’audio ». Spotify la rachètera quelques années plus tard pour en faire sa brique d’hébergement. Preuve que ces tentatives de rendre l’audio social ne datent pas d’hier.
Ces déclinaisons audio-visuelles restent un moyen incontournable de donner de la visibilité à un travail sonore. Mais un moyen fragile, qui finit par détourner le regard du cœur du podcast : l’écoute.
Ce glissement vers la fabrication de méta-contenus est un leurre : il arrache le podcast à son territoire d’origine, celui de l’écoute, pour le jeter dans celui du scroll. Là où tout se voit, mais rien ne s’entend vraiment.
L’illusion des codes sociaux
Pour rendre visibles nos podcasts, nous avons toutes et tous bricolé ces formats « extra » : audiogrammes, extraits courts, punchlines isolées sur un visuel, stories, vidéos adaptées aux réseaux. Peu à peu, ces logiques sont devenues le passage obligé de la visibilité sonore.
En reprenant ces codes, les plateformes audio et vidéo tentent d’en faire une norme. Elles veulent faire croire que le podcast doit adopter les réflexes du social : être filmé, découpé en extraits rapides, pensé pour le scroll. Or, si tout l’effort créatif se déplace vers ces déclinaisons, que reste-t-il de l’œuvre sonore ?
Le podcast devient une série d’extraits interchangeables, un bruit de fond à l’image.
L’économie de l’attention à l’assaut de l’écoute
On nous explique que les formats qui « marchent » sont les talk-shows filmés, les conversations brutes, les capsules taillées pour la viralité. C’est vrai : ils cochent toutes les cases de l’algorithme.
Mais cette conformité a un prix : ce qu’ils gagnent en visibilité, ils le perdent en profondeur. C’est là que réside le danger du podcast social. Non pas seulement dans l’arrivée de la vidéo, mais dans le déplacement des critères de valeur.
On entre dans ce qu’on appelle l’économie de l’attention : un système où la ressource la plus précieuse n’est plus le contenu, mais le temps que l’on parvient à soutirer à l’auditeur ou l’auditrice. Tout est pensé pour capter, retenir, occuper. Nous y sommes : dans une économie qui ne cherche plus à nourrir, mais à retenir. L’auditeur n’est plus une oreille, il devient un flux. Et le son, une donnée parmi d’autres.
Dans ce cadre, les podcasts ne sont plus jugés à l’aune de leur inventivité ou de leur profondeur, mais de leur capacité à générer du flux : publier souvent, accumuler des écoutes, rester visibles dans les tops… et, de plus en plus, produire sans cesse du méta-contenu pour alimenter les réseaux sociaux. Autrement dit, l’effort créatif se déplace du son vers ses déclinaisons sociales.
Cette bascule a une conséquence directe : elle rend invisibles les formats plus exigeants (documentaires, fictions, créations d’auteur·ices) et elle renforce les formats les plus standardisés.
L’algorithme adore la répétition, mais la répétition n’a jamais fait un imaginaire.
Le podcast, qui ouvrait un champ de possibles sonores, se trouve réduit à un décor de studio filmé.

Le contrepoint : un social humain
Et pourtant, un autre social existe déjà. Bien avant l’explosion du podcast, des émissions de radio circulaient en MP3, partagées sur des plateformes de téléchargement musical comme Emule ou Napster. C’est ainsi que, loin de la capitale ou à des horaires peu propices à l’écoute en direct, alors que le replay n’existait pas encore, les top replay mp3 s’appelaient Le Monde de Monsieur Fred (Oui FM) ou La Lettre de Guy Carlier (France Inter).
Pour les auditeurs et auditrices en soif de partage, il fallait prendre la peine d’enregistrer, de convertir, de mettre à disposition les contenus. Une forme artisanale de circulation qui montrait déjà une chose simple : l’audio appelle le partage.
Le podcast n’a fait qu’amplifier cette logique. Sa vraie force repose depuis toujours sur le bouche-à-oreille : un ami qui recommande une série, une collègue qui envoie un lien, une communauté qui partage ses découvertes. Ce type de recommandation est profondément qualitatif : il repose sur une écoute complète, une expérience vécue, et sur la confiance entre auditeur·rices.
C’est une forme de recommandation humaine, qui s’inscrit dans ce qu’on appelle la curation : sélectionner, rééditorialiser, partager avec un supplément d’âme.
En parallèle du modèle algorithmique, les créateurs et créatrices sonores n’ont cessé de se regrouper pour défendre une écoute indépendante : des collectifs comme Les Sons Fédérés, Transmission ou Les Podcasteur·eu·s·e·s du Sud, mais aussi de nouveaux festivals dédiés au son et au podcast : PodRennes et PodParis, Podcast Hôtel à Lyon, Destination Podcast au Puy en Velay, ou à Marseille La Claque Podcast Party et le tout nouveau festival Bruits Roses consacré à la création sonore en Méditerranée. Autant d’espaces où le partage reste humain, artisanal, vivant.
C’est dans cet esprit qu’Elson a relancé son comité d’écoute, Oreilles Curieuses : un espace pour faire circuler le son autrement, à contre-courant du scroll, à hauteur d’oreille.
Mais cette démarche pose une question : comment rester fidèles à cette logique d’écoute, tout en allant chercher le public là où il est, sur les réseaux, dans ces espaces façonnés par l’économie de l’attention ?
C’est la tension qui traverse tout notre travail : écouter à contre-courant. Chercher la justesse plutôt que le volume. Et rappeler, encore, que le son n’a pas besoin d’être visuel pour être entendu.
Cet article s’inscrit dans le dossier “Penser le son”, une série consacrée aux mutations du podcast à l’ère des plateformes.
À lire aussi : “Du RSS à la vidéo : comment Spotify et YouTube essaient de déplacer le podcast”.